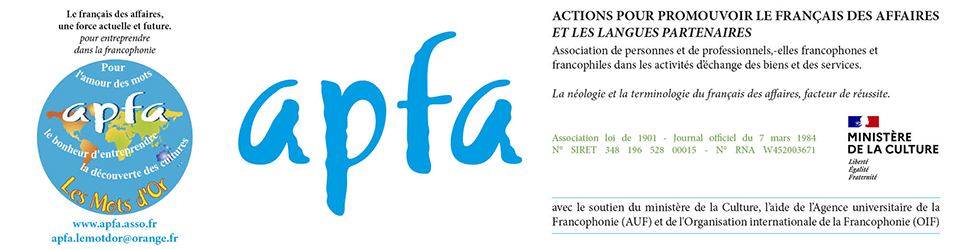Certains sujets du Mot d’Or comprenaient un exercice étymologique. Les candidats devaient choisir, en mettant une croix dans la case correspondante, l’origine étymologique qui leur semblait être la bonne pour deux ou plusieurs mots du français des affaires.
Vous pouvez vous tester sur quelques uns de ces exercices.
Auteur : Jean Marc CHEVROT.
[HDquiz quiz = « 93 »]